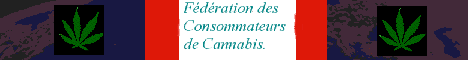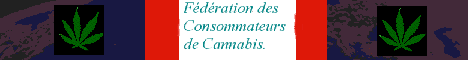| |
Parmi ceux qui
ont sablé le champagne quand Ruth Dreifuss a présenté le nouveau
projet de loi sur les stupéfiants il y a dix jours, certains
producteurs et vendeurs se sont réjouis un peu trop vite.
Les nouvelles mesures pourraient signifier la fin de l'âge
d'or du chanvre «récréatif».
La tolérance officiellement accordée s'accompagnera de mesures
qui exigeront une révolution copernicienne chez des militants
du chanvre que la semi-clandestinité arrangeait assez bien
Les plus prévoyants ont anticipé les contrôles à venir. Quant
aux pays voisins, ils observent l'expérience avec un intérêt
teinté d'agacement: les exportations de chanvre suisse les
inondent depuis plusieurs années déjà.

|
|
Voici au moins,
autour d'Expo.02, un projet clair qui avance son bonhomme
de chemin.
André Furst avait
proposé aux responsables d'aménager une ferme modèle
montrant les nombreux atouts du chanvre. Recalé. Qu'à
cela ne tienne, il retape en bordure de la route cantonale
à Morat une exploitation où pourront s'arrêter tous
les visiteurs en route pour l'Expo.
André Furst a eu fin nez. C'est l'année prochaine que
sera discutée au parlement la nouvelle loi sur les stupéfiants
qui, si le projet actuel passe, fera de la Suisse un
pionnier européen en matière de dépénalisation du cannabis
(voir le tableau ci-contre). Que ce réduit alpin conservateur
puisse doubler les Pays-Bas dans un domaine aussi sensible
suscite à l'étranger froncements de sourcils réprobateurs
ou hilarité incrédule.
Les caméras de
la chaîne M6 ont déjà filmé les stocks du Valaisan Bernard
Rappaz «prêt à conquérir le marché». L'intéressé a récemment
testé sa popularité au Salon de l'agriculture de Paris
et, sur la base d'un calcul de consommation très personnel,
estime la surface agricole que nécessitera la consommation
nationale de chanvre «récréatif»: 4000 hectares.
C'est énorme, même si cela ne représente encore qu'un
pour cent des terres cultivables. Aujourd'hui, la Suisse
recense 105 hectares de cultures chanvrières destinées
(en principe) à l'industrie, auxquels s'ajoutent 200
à 300 hectares non déclarés. A entendre Ueli Locher,
vice-directeur de l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP), la dépénalisation ne devrait guère augmenter
cette superficie: «Nous savons qu'il existe actuellement
une exportation assez conséquente de cannabis. La nouvelle
loi l'interdit explicitement et introduira des contrôles
stricts. Cette partie de la production devrait donc
diminuer.»
Entre 400 et 4000 hectares, qui dit juste? Probablement
ni l'un ni l'autre. L'OFSP marche sur des œufs, il a
tout intérêt à minimiser son audace et ses conséquences
vis-à-vis de l'extérieur. Bernard Rappaz, lui, est un
militant qui résout tous les problèmes, y compris celui
de la vache folle, par le chanvre. Entre les deux, François
Reusser, président de la Coordination suisse du chanvre
qui regroupe 150 membres sur quelque 250 commerces actifs
en Suisse, pense que la surface cultivée en chanvre
«ne dépassera pas 500 à 600 hectares».
Pour l'évaluer, l'étude la plus solide est celle de
l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres
toxicomanies (ISPA) qui recense 87 000 consommateurs
quotidiens de cannabis (dont 26 000 jeunes entre 15
et 19 ans). On relèvera au passage qu'elle les définit
comme des personnes «ayant une consommation problématique
de cannabis», ses auteurs ajoutant ailleurs qu'«il est
très difficile de définir des valeurs limites du point
de vue scientifique». Quant au nombre de consommateurs
irréguliers, il est estimé à 400 000-500 000 personnes.
L'incertitude scientifique relevée par l'ISPA jointe
à une base législative mouvante ont amené le Conseil
fédéral à se barder de précautions. A tel point qu'on
peut se demander si les nouvelles mesures ne signifient
pas en réalité la fin d'un certain âge d'or pour les
producteurs et vendeurs de chanvre «récréatif». Jusqu'ici,
ils risquaient (un peu) le bâton du gendarme, les seconds
surtout. Quant aux producteurs, voici les propos éloquents
que tient un agriculteur valaisan: «Je ne connais pas
la teneur en THC (le principe actif du cannabis, ndlr)
de ce que je plante, ça ne me regarde pas trop tant
qu'on me paie. Je reçois les semences et fais confiance
à mon fournisseur. Je me dis parfois que tous ceux qui
viennent piquer des plantes la nuit, c'est sans doute
pas pour faire des tisanes.»
Cette semi-clandestinité contournée dans la joie et
la bonne humeur se retrouve dans certains réseaux de
distribution. Que le Tessin compte plus de quarante
commerces de chanvre malgré la petite dizaine fermés
récemment pour une population comparable à celle du
Berne, où ne se trouvent que dix magasins, en dit long
sur les innombrables ruisseaux qui ont fini par former
un fleuve d'exportations.
Or la dépénalisation s'accompagnera d'un serrage de
vis très sensible. Plus d'importations ni d'exportations:
le chanvre suisse alimentera tout le marché national
«récréatif» et rien que lui. Le changement se fera surtout
sentir pour les producteurs. Fini de fermer les yeux,
ils devront déclarer la moindre culture chanvrière,
contrôler le taux de THC et dire très précisément à
quel grossiste – suisse exclusivement – ils vendent
la plante destinée au plaisir. Armin Käser, dont la
ferme Cannabioland à Litzisdorf (FR) employait une cinquantaine
de personnes jusqu'à sa fermeture en juillet dernier,
accueille favorablement ces contrôles dans la mesure
où ils amélioreront la traçabilité des produits et écarteront
du marché «ces gens peu fiables qui dopent leurs plantes
sous serres ou avec des produits chimiques». Dans les
nuages opaques de la production de chanvre, on n'est
pas toujours tendre les uns avec les autres. «Je suis
devenu très méfiant, les membres ne veulent pas dire
ce qu'ils font», confie l'agronome Pierre-François Lavanchy,
président démissionnaire d'une association des chanvriers
en sommeil.
Un point de la loi laisse Armin Käser perplexe. «Il
est dit que les gains provenant du chanvre récréatif
ne devront pas être «excessifs». Qu'est-ce que ça signifie?»
La question n'est pas anecdotique: si le chanvre industriel
a une rentabilité proche des cultures céréalières, le
«récréatif» peut rapporter jusqu'à un demi-million de
francs par hectare...
Cela dit, on peut aussi s'attendre à une certaine baisse
des prix quand le cannabis sera dépénalisé. David Vallat,
gérant de Cannabou S. à r.l., pense que le prix chutera
de 1 à 2 francs par gramme – si des taxes ne viennent
pas le grever en contrepartie: «Actuellement, les marges
du vendeur sur le chanvre récréatif sont de 30 à 50%
– moins que pour des jeans Levi's.» David Vallat se
dit prêt à assumer les contrôles beaucoup plus serrés
qu'exigera la nouvelle loi: «Aujourd'hui déjà, nous
vérifions les pièces d'identité dans nos deux magasins
jurassiens, y compris les passeports suisses des doubles
nationaux établis à Besançon!»
Les militants du chanvre qui ont vécu si longtemps dans
un certain confort de la marge sont-ils tous prêts à
se doubler de gestionnaires rigoureux? Quand on interroge
Bernard Rappaz sur son chiffre d'affaires annuel, il
commence par s'excuser d'avoir changé récemment de comptable
et finit par articuler: «Environ un million par année.»
Pour une dizaine de collaborateurs et une douzaine de
fournisseurs réguliers? On n'est pas obligé de parier
un pétard sur l'exactitude de ces chiffres.
|
| Date de parution:
|
Lundi 19 mars 2001
|
| Auteur: |
Jean-Claude Péclet
|
«En
brisant le tabou, on diminue aussi l'attrait du
produit interdit»
Propos recueillis par Jean-Claude Péclet
L'association Chanvre à part, à Genève, a édité
un règlement de vente qui anticipe l'ordonnance
d'application de la nouvelle loi sur les stupéfiants.
Fabien Piccand a corédigé en 1997 un rapport détaillé
sur l'expérience de vente réalisée pendant huit
mois par trois cafés à chanvre genevois (Delta
9, Otaku et Punta Roja). Membre de l'association
Chanvre à part, il a également participé l'an
dernier à la rédaction d'un «Modèle de vente contrôlée»
que les membres s'engagent à respecter.
Le Temps: La consommation de cannabis augmentera-t-elle
en Suisse avec la dépénalisation?
Fabien Piccand: Aujourd'hui, l'accessibilité aux
dérivés du chanvre est quasi totale. La plupart
de ceux qui voulaient les essayer l'ont fait.
Le précédent hollandais montre que la consommation
a stagné pendant les deux ans qui ont suivi la
dépénalisation, puis a commencé à baisser. Une
des raisons est qu'en brisant le tabou, on diminue
aussi l'attrait du produit interdit.
– La loi veut interdire l'exportation, florissante
aujourd'hui. Y parviendra-t-elle vraiment?
– Tout producteur sera automatiquement sous contrat
avec un distributeur suisse lui-même tenu à une
comptabilité précise. Les augmentations suspectes
de volume seront donc plus faciles à détecter
qu'aujourd'hui, où les cultures sont tolérées
tandis que règne une grande opacité sur l'usage
final qui est fait du chanvre.
– Reste le tourisme du joint, très actif – on
dénombre une cinquantaine de magasins au Tessin.
Pourra-t-on vraiment contrôler l'identité des
clients pour appliquer l'interdiction de vente
à des étrangers?
– C'est vrai qu'aujourd'hui, le gramme de haschisch
se vend deux fois plus cher à Lyon qu'à Genève
pour une qualité inférieure. Cette différence
reflète la marge de risque que prend le vendeur
puisque la France conserve une politique répressive.
Le trafic s'y déplace vers des banlieues moins
sûres ainsi que vers Genève, où viennent à la
fois acheteurs et vendeurs. Notre réponse à ce
problème est la vente-conseil en magasin. Il est
important que le vendeur connaisse sa clientèle,
passe un peu de temps avec l'acheteur, n'hésite
pas à demander les papiers d'identité et de domicile
s'il voit une nouvelle tête.
– La réalité est moins claire. Ainsi, les trois
points de vente genevois dont vous avez suivi
l'expérience en 1997 ont vite été débordés par
la demande.
– Nous étions alors les seuls à Genève, absorbant
90% de la demande qui fut amplifiée par certaines
manchettes de journaux. C'est pourquoi nous avons
pris la décision d'arrêter l'expérience un mois
avant la rentrée scolaire. La police est intervenue
dix jours avant la date que nous avions fixée.
– Selon vous, combien de points de vente faudrait-il
pour une ville comme Genève?
– D'après nos estimations, vingt-cinq lieux permettraient
de satisfaire tout le monde. Nous en proposons
quinze dans une première phase.
– Etes-vous favorable à une clause du besoin?
– Oui. Certes, elle a montré ses limites avec
les cafés-restaurants, les problèmes de pas-de-porte
qu'elle crée. Mais elle a bien fonctionné pour
réglementer le marché de l'alcool quand c'était
nécessaire. Nous pensons que la situation n'est
guère différente pour le chanvre.
– Comment éviter la revente aux mineurs si l'accès
devient beaucoup plus aisé?
– Les adolescents ont déjà de larges possibilités
de s'approvisionner. Nous regrettons que le Conseil
fédéral propose de fixé la limite d'âge à 18 ans
et non à 16. Les jeunes sont ceux qui ont le plus
besoin de l'encadrement que peut fournir un point
de vente contrôlé, tandis que le marché noir les
fragilise. Nous sommes aussi favorables à une
prévention scolaire comme elle se pratique pour
l'alcool.
– Qui sera le mieux armé pour contrôler l'efficacité
des mesures proposées?
– Nous sommes prêts à créer notre propre commission
de contrôle. Mais l'idéal serait qu'à l'échelon
genevois par exemple, ce travail soit confié à
la commission mixte en matière de drogue déjà
existante. Son indépendance serait un facteur
d'efficacité. La difficulté pour l'Etat vient
du concept même de dépénalisation: il tolère sous
conditions la production, la vente, la possession
et la consommation d'un produit qui reste en principe
interdit. Il ne peut donc créer une régie du chanvre
comme il a créé jadis celle des alcools. Nous
le regrettons, car l'histoire de la régie des
alcools montre justement qu'on arrive à contrôler
les circuits de vente d'un produit et à en diminuer
certains effets négatifs. 
|
|
L'Europe
entre scepticisme et réticences
Jean-Claude Péclet
La Suisse va faire un effort d'information
auprès de ses voisins sceptiques. N'est-ce pas
déjà un peu tard?
Même les Pays-Bas, paradis traditionnel des fumeurs
de joints, n'ont pas une loi aussi libérale à
propos du cannabis que celle proposée par le Conseil
fédéral. L'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) avance donc sur la pointe des pieds pour
ne pas brusquer les pays limitrophes. «Nous ne
voulons pas créer des problèmes de voisinage,
comme il a pu s'en produire entre la France et
la Hollande. Ces prochains mois, nous aurons une
série de contacts personnels avec plusieurs responsables
de la politique de la drogue pour expliquer notre
projet», dit Ueli Locher, vice-directeur de l'OFSP.
Des rencontres sont prévues dans les zones frontalières
où se concentre le tourisme chanvrier, contact
est déjà pris avec la ministre allemande de la
Santé ainsi qu'avec la coordinatrice interministérielle
française pour les problèmes de drogue.
A Bonn toutefois, on «regrette» que la Suisse
n'ait pas officiellement consulté ses voisins
avant de ficeler son projet. Cela dit, la forte
attraction qu'exercent notamment les magasins
bâlois sur les jeunes Allemands est un phénomène
connu. Sans citer de chiffres précis, Hugo Michels,
du bureau chargé de la politique antidrogue, estime
que la quantité de chanvre récréatif exportée
par des vendeurs suisses en Allemagne a progressé
dans des proportions excédant cent pour cent chacune
de ces dernières années. «Pour nous, le problème
est d'abord ce marché gris, dit Hugo Michels.
Et il faudra encore attendre deux ou trois ans
avant que la nouvelle loi suisse entre en vigueur;
pendant ce temps les ventes illégales continueront
de se développer.»
En France, on espère que la nouvelle loi «cadrera»
plus précisément qu'aujourd'hui la production
et la vente de cannabis. Quant au secrétaire du
Bureau de contrôle antidrogue de l'ONU à Vienne,
Herbert Schaepe, il déclare à l'hebdomadaire alémanique
Facts que la nouvelle loi suisse «mine la convention
de 1961 interdisant les substances engendrant
la dépendance, convention qu'elle a pourtant elle-même
ratifiée». Ce texte interdit la production, la
possession et la consommation de stupéfiants,
sauf pour usage médical, et en établit une liste
détaillée. Un Etat signataire peut demander à
exclure une substance de la liste, mais la Suisse
n'a pas entrepris une telle démarche, précise
le secrétariat viennois. D'une manière générale,
l'autorité onusienne se montre très réticente
face aux expériences suisses en matière de politique
de la drogue.
Le Valaisan Bernard Rappaz résume ainsi le climat
prévalant dans la branche: «Les chanvriers ne
sont pas particulièrement proeuropéens. Ils ont
peur de perdre la liberté extraordinaire dont
ils bénéficient en Suisse.» 
© Le Temps. Droits de
reproduction et de diffusion réservés. www.letemps.ch
|
|
|
eh, oui, c'est ainsi:
Le monde politique suisse
va dépénaliser le cannabis.......
mais le monde juridique,
lui, renforce la répression POURQUOI?
Chiffelle
Pierre interpelle .....Ruth Dreifuss
nov
2000
|