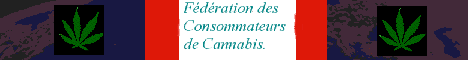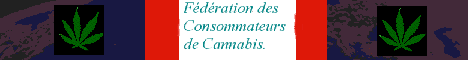|
CONFERENCE DES PRESIDENTS
DES TRIBUNAUX D'ARRONDISSEMENTS
ET DES JUGES D'INSTRUCTION
Séance
de travail du 14 mai 1997
Présents : MM.
Louis Sansonnens, Jean-Pierre Schroeter, Jean-Luc
Mooser, Carlo Bulletti, André
Piller, Peter Rentsch,
Jacques Rayroud, Nicolas Ayer,
Philippe Vallet.
Excusés : MM. Chanez,
Lamon, Waeber, Raemy.
Invités
Présents : Mme le Procureur,
Mme Françoise Morvant, MM. Cornu
et Papaux, MM Pierre Nidegger et
Peter Baeriswyl.
Excusée : Mme Henninger.
Carlo Bulletti aborde tout d'abord
le problème posé par le
Cannabioland à Litzistorf.
Selon lui, la question n'est
pas de savoir si le chanvre est une
culture autorisée au
non, car la culture est autorisée pour
autant que le chanvre ne soit
pas utilisé comme stupéfiant. Le
problème du chanvre et
de son utilisation est toutefois
complexe. En effet, si l'on
prépare un thé à base àe chanvre
avec de l'eau chaude, le THC
ne passe pas dans l'eau, car non
solvable dans l'eau. En soi,
une telle consommation serait
licite. En revanche, si on ajoute
du lait, comme le THC est
soluble dans les graisses, l'effet
chanvre se produit car le THC
se dissout dans le lait puisque
celui-ci contient des corps
gras.
Jean-Pierre Schroeter nous informe
ensuite qu'il a été confronté
avec l'avocat ou ex-avocat Egger,
et qu'à cette occasion il a
été amené
à prendre contact avec le professeur Rivier de
Lausanne. Ce dernier a élaboré
un document relatif au taux de
THC, déterminé
à partir d'analyse chimique. Selon le professeur
Rivier, il existe plusieurs
sortes de chanvre, la Confédération
subventionnant la culture de
chanvre si le THC contenu est
inférieur à 0,5
:. Jean-Pierre Schroeter produit le document
élaboré par le
professeur Rivier, lequel est annexé au présent
procès-verbal.
– 2 –
Il en ressort
que la détermination du THC est possible par
analyse. De plus, Jean-Pierre
Schroeter estime que le
Canabioland tombe sous le coup
de l'art. 19 de la loi fédérale
sur les stupéfiants gui
prévoit "prendre des mesures en vue
d'obtenir ces résultats".
Pierre Nidegger expose ensuite
que chaque agriculteur suisse est
fondé à planter
du chanvre dit agricole. Lui-même a abordé
l'Institut de Grangeneuve, afin
de déterminer les applications
possibles du chanvre. Selon
l'Institut, le chanvre n'est pas
rentable utilisé comme
matériau. De plus, chaque agriculteur
désireux de pIanter du
chanvre doit se fournir auprès du
fournisseur officiel fédéral,
à Thun.
Après discussion, la
conférence décide d'arrêter l'attitude
suivante :
En présence de "plantes
officielles" donc de plantes
subventionnées, il est
décidé de tenir les plantations pour
licites.
A contrario, la plantation de
plantes non officielles doit être
tenue pour illicite et leur
destruction doit être ordonnée.
Entrée en vigueur du
CPP
Selon Jacques Rayroud, cette
entrée en vigueur a été repoussée
au ler juillet 1998 pour des
iaisons budgétaires, car le Conseil
d'Etat ne voulait pas mettre
sur pied une cession extraordinaire
du parlement. Il faut en effet
engager du personnel
supplémentaire et tout
est lié.
I annexe no 3
Les membres de la conférence procèdent
à l'examen de l'annexe no
3 relative à l'entrée en vigueur du CPP.
a) Jean-Luc Mooser relève
tout d'abord les problèmes liés à la
qualification des fonctions.
L'Office des Juaes
l
d'Instruction souhaite
introduice des greffiers. Ceci
devrait
être mentionné dans le rapport p. 6 et nécessite
une
modification de l'act. 15 LOJ,
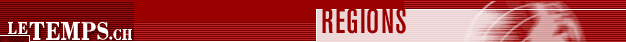
FRIBOURG. L'une des
dénonciatrices de l'ancien policier Paul Grossrieder est acquittée,
au bénéfice du doute, de l'accusation d'escroquerie à l'assurance
incendie. Défense et accusation ont dénoncé les hésitations
de l'instruction.
20 février 2001
L'incendie qui a mis le feu à la justice et à la police
fribourgeoise garde tout son mystère
Willy Boder
Mardi 20 février 2001
Fait exceptionnel.
Dans le cadre d'un procès qui apparaît en filigrane de ceux
de Paul Grossrieder, ancien chef de la brigade des stupéfiants,
ainsi que du commandant de la police cantonale, Pierre Nidegger,
et qui ont agité la police et la justice fribourgeoises l'an
dernier, défense et accusation sont tombées d'accord sur les
graves erreurs commises par la police et les pressions incompréhensibles
de l'instruction judiciaire.
Jugée lundi, plus de sept ans après les faits, cette affaire
débute samedi 10 juillet 1993 à 18 heures, par l'incendie
d'un salon de beauté en ville de Fribourg. Les nombreux policiers
dépêchés sur place concluent rapidement à un incendie accidentel,
alors que tout porte à croire, sur la base d'une expertise
réalisée en 1998 sur demande du juge Patrick Lamon, que l'incendie
est d'origine criminelle.
L'affaire met en lumière, une nouvelle fois, les relations
troubles entre certains policiers et le milieu de la prostitution
et de la petite délinquance fribourgeoises. Comme dans les
procès précédents, la justice, égarée par des déclarations
fracassantes retirées quelques semaines ou quelques mois plus
tard, démunie de preuves solides, doit se résigner à acquitter
au bénéfice du doute.
Le contexte de l'incendie du salon de beauté, fait de jeux
d'ombres et de lumières, de vrais mensonges opposés à de fausses
contrevérités, est exactement celui qui éclatera au grand
jour, en mars 1998, lors de l'arrestation de Paul Grossrieder,
et de son collègue Albert Perler, ancien sous-chef de la brigade
judiciaire, devenu responsable de l'entraînement des chiens
policiers.
D, tenancière de salons de beauté et prostituée, indirectement
mêlée aux affaires de la justice et de la police, a été jugée
lundi par le Tribunal pénal de la Sarine. Reconnue notamment
coupable de vol et d'escroquerie pour avoir astucieusement
profité de cartes de crédits dérobées, elle écope d'une peine
de 8 mois de prison avec sursis durant cinq ans, qui vient
s'ajouter à une condamnation précédente de 10 mois avec sursis.
D, et c'est là l'essentiel, a cependant été acquittée, faute
de preuves, de toute participation, directe ou indirecte,
à l'incendie de l'un de ses salons de beauté. Elle a touché
104 000 francs de la compagnie d'assurance, malgré la méfiance
de l'un des responsables du sinistre, qui affirme avoir subi
des pressions d'un policier pour procéder rapidement au versement.
Le policier, frère d'un tenancier de bar fréquenté par des
prostituées, accusé d'entrave à l'action pénale suite à de
forts soupçons de falsification du rapport de police sur l'incendie,
a été blanchi. Mis au bénéfice d'un non-lieu, il a obtenu
30 000 francs de dommages et intérêts.
D n'est pas une délinquante ordinaire. Tantôt informatrice
de la police, tantôt prostituée, à l'occasion dénonciatrice
de Paul Grossrieder, elle a également passé plus de 6 mois
en détention préventive sur ordre du juge Lamon qui pensait
pouvoir, grâce à elle, démanteler un réseau d'influences au
sein de la police.
«Rarement un incendie aura provoqué autant de fumée et si
peu de flammes, souligne Marc Bugnon, substitut du procureur
du canton de Fribourg. Cette affaire aura marqué par la lenteur
et les errements de la police et de la justice».
Le défenseur de D est du même avis. «Vous êtes tributaires
d'une enquête policière bâclée et d'une instruction judiciaire
dirigée», lance-t-il aux juges du Tribunal de la Sarine.
Car on peut retourner les faits comme on veut. De deux choses
l'une. Ou les nombreux policiers qui se sont occupés de cet
incendie ont fait preuve de graves manquements professionnels
en écartant d'emblée l'hypothèse de l'acte criminel malgré
des indices accablants (difficultés financières de D, lettre
antidatée, mise en congé troublante, disparition de preuves
matérielles, méfiance de l'assurance, entrée en scène d'un
ancien pyromane).
Ou, plus grave, une partie de la police était sous influence,
comme tentait de le prouver le juge Patrick Lamon, qui a dû
quitter ses fonctions. Cette thèse est notamment accréditée
par certaines déclarations d'un assureur, et par l'aveu de
D, retiré par la suite, de relations sexuelles avec un policier.
Dans ce contexte, nombreux sont les Fribourgeois à espérer
que le prochain rapport de la juriste neuchâteloise Barbara
Ott, commandé par le gouvernement, apporte enfin des réponses
convaincantes à ces graves questions.
|