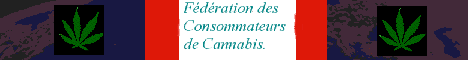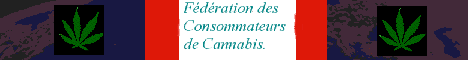Berne, Avril
1999
Résumé
La Commission pour les problèmes liés aux
drogues (CFD) est une commission extraparlemenaire nommée
par le Conseil fédéral. Ses membres, des spécialistes de
différentes disciplines, traitent professionnellement de
certains aspects du problème de la drogue. Cette commission
conseille le Conseil fédéral dans les questions fondamentales
liées à la politique de la drogue.
Elle a rédigé un rapport dans lequel elle
fait le point de la situation en Suisse en ce qui concerne
le cannabis et, à partir de cette analyse, formule des propositions
pour la politique future, en particulier dans l'optique
de la révision de la loi sur les stupéfiants.
La Commission est arrivée à la conclusion
qu'une réévaluation de la question du cannabis était nécessaire,
tant du point de vue du rôle de celui-ci comme drogue d'agrément
que de son emploi éventuel à des fins médicales.
Le rapport ne traite que marginalement de
l'usage médical du cannabis. Se fondant sur la littérature
médicale internationale, la commission recommande l'adoption
d'une base légale permettant la mise en œuvre de projets
de recherche contrôlés sur l'usage thérapeutique du cannabis
en Suisse.
En ce qui concerne la consommation du cannabis
comme produit d'agrément, la situation en Suisse s'est modifiée
de façon toujours plus marquée au cours des dernières années.
En l'occurrence ce ne sont pas les nouvelles connaissances
sur les effets du cannabis qui ont joué le rôle prédominant,
les recherches les plus récentes ayant tout au plus confirmé
ce que l'on savait déjà. C'est bien plutôt la façon dont
est perçu le cannabis dans la société qui a subi une évolution
considérable. C'est ainsi que les nouvelles habitudes de
consommation du cannabis ont fait de celui-ci un produit
d'agrément qui est consommé par une grande partie de la
population sans aucun sentiment de faute et sans faire la
moindre relation avec les drogues dites dures. Il est résulté
de cette évolution des frictions toujours plus nombreuses
entre les prescriptions juridiques régissant la consommation,
l'acquisition et l'accessibilité du cannabis, d'une part,
et les problèmes de leur application, d'autre part.
Les expériences faites par le passé montrent
très clairement qu'une politique basée sur la prohibition
ne permettait pas d'empêcher cette évolution. Cette politique
a bien davantage conduit à une perte croissante de crédibilité
de la politique de l'Etat en matière de drogue, perte encore
accentuée par les pratiques divergentes des cantons en matière
de poursuite des consommateurs et des petits trafiquants
de cannabis.
Dans ce contexte la commission a examiné
de manière approfondie dans quelle mesure une adaptation
de la législation concernant les produits du cannabis pourrait
être envisagée. Elle est arrivée à la conclusion que la
consommation de cannabis – comme la consommation
de toute substance agissant sur le système nerveux central
– peut présenter certains risques, mais que l'on ne
dispose pas de connaissances, établies de manière certaine,
selon lesquelles il existerait un risque de toxicité alarmant.
En outre, elle constate que les consommateurs de cannabis
peuvent aujourd'hui en obtenir partout et sans problèmes,
et, dans la très grande majorité des cas, sans risquer de
sanctions – un fait qu'il ne faut jamais oublier
lors de l'examen de modèles d'accessibilité légale.
Après cette analyse de la situation, le
rapport présente les options que la Suisse peut envisager
dans le cadre d'une révision de la loi sur les stupéfiants.
Etant donné que les Conventions internationales (notamment
la Convention unique sur les stupéfiants de 1961) jouent
un rôle capital s'agissant de décisions politiques, le rapport
distingue les options qui peuvent être réalisées en conformité
avec ces conventions et celles qui ne peuvent pas l'être.
Pour chaque option sont exposées les conséquences qu'elle
pourrait avoir sur la propension à consommer, les habitudes
de consommation, les répercussions sur le marché illégal
et sur la nécessité de réglementer. Un chapitre est consacré
à l'évaluation des différentes options quant aux possibilités
qu'elles offrent de réaliser une série de buts de la politique
en matière de cannabis. En l'occurrence le but primordial
de la politique future en matière de cannabis est la mise
en place de conditions cadre qui permettent d'empêcher dans
la mesure du possible les conséquences indésirables de sa
consommation.
La solution que la commission recommande,
qui est conforme avec la Convention unique de 1961, est
une révision de la loi sur les stupéfiants qui dépénalise
la consommation de cannabis et les actes liés à son acquisition
à des fins de consommation personnelle. En outre, la loi
sur les stupéfiants devrait créer les bases nécessaires
pour une réglementation qui permette à la police et à la
justice de renoncer, dans des conditions clairement définies,
à poursuivre le petit trafic, y compris par métier (principe
d'opportunité).
Autre option, qui ne serait toutefois pas
compatible avec les conventions internationales, la commission
propose l'élaboration d'un modèle de commerce sous licence
avec des critères définis pour l'obtention d'un permis d'acquisition.
Un tel modèle permettrait d'acquérir du cannabis légalement
non pas dans le sens d'une liberté de commerce, mais d'un
commerce soumis à une réglementation claire. La densité
de celle-ci devrait être suffisante pour faire droit aux
objectifs de la politique en matière de cannabis. Elle trouverait
ses limites là où un excès de régulation favoriserait le
maintien du marché noir. Concrètement, du côté du commerce,
il faudrait poser des exigences en matière de formation
professionnelle, prévoir des prescriptions concernant la
remise et les produits, interdire la publicité, introduire
des taxes fiscales et le cas échéant, des prix imposés.
Du côté des consommateurs, une limite d'âge devrait être
prévue et, pour prévenir le tourisme de la drogue, exiger
la présentation du certificat de domicile lors de chaque
acquisition.
Du point de vue technique, la commission
préfère le modèle de licence car il offre des conditions
cadre précises et réalisables. Elle est d'avis que ce modèle
est davantage crédible qu'un modèle dans lequel subsistent
les points de friction existants entre une interdiction
de principe du trafic et une tolérance limitée. Le choix
du législateur se fera cependant en fin de compte sur des
critères politiques et non pas techniques.