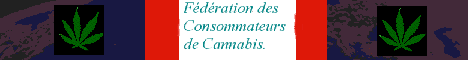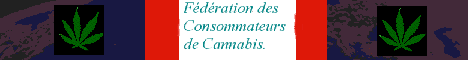|
SANTE. Une enquête
nationale révèle une forte augmentation de la
consommation de tabac et de haschisch chez les 15 à
24 ans. Les Alémaniques se montrent plus "fit"
que les Latins
Comment vont les Suisses? Les vieux
ont le moral, les jeunes fument trop
Ludovic Rocchi, Berne
L'Office fédéral de la statistique a pris le
pouls de la population. Comparés à son enquête
de 1992, les chiffres recueillis auprès d'un échantillon
de 13 000 personnes en 1997 démontrent que les Suisses
continuent de se sentir bien dans leur corps. A la question
"comment allez-vous en ce moment?", 86% des hommes
et 82% des femmes ont répondu par "bien"
ou "très bien". En revanche, seule une personne
sur deux affirme se sentir bien sur le plan psychique. Si
le sentiment de nervosité ou de déprime s'est
légèrement atténué par rapport
à 1992, il gagne davantage les jeunes. Phénomène
inquiétant qui se traduit notamment par un pourcentage
tout de même élevé des 15-24 ans estimant
que leur vie n'a pas de sens (7%) ou déclarant ne pas
être heureux (4%). Et, surtout, quand ils ne sont pas
déjà chômeurs, ils sont 18% à craindre
de perdre leur emploi, chiffre qui se retrouve au niveau de
l'ensemble des personnes actives.
La même catégorie des 15-24 ans se retrouve touchée
par une forte hausse de la consommation de produits nocifs.
La part des jeunes fumeurs a ainsi augmenté de 40%
en cinq ans. L'attrait croissant du tabac est particulièremnt
marqué auprès des filles. Le nombre total de
fumeurs, lui, progresse de 2,6%. Les chiffres sont aussi corsés
pour le haschisch: la proportion des 15 à 39 ans avouant
avoir fumé un joint au moins une fois dans leur vie
grimpe à 26,7% (16,3% en 1992). Cette proportion atteint
près de 43% chez les jeunes hommes de 20 à 24
ans. On observe une croissance même chez les non-fumeurs.
Mais lorsque la question concerne la consommation régulière,
le pourcentage devient tout de suite plus modeste (voir tableau).
Idem pour les drogues dures, où la consommation d'héroïne
stagne, tandis que la cocaïne est de plus en plus en
vogue chez les adultes: 7% des hommes de 25 à 39 ans
et 3% des femmes ont déclaré avoir "sniffé"
au moins une fois, soit près du double qu'en 1992.
En comparaison européenne, la Suisse confirme sa forte
consommation de substances dites psychoactives. Mais si l'état
psychique et toxicodépendant des jeunes est décrit
comme "préoccupant", les comportements "favorables"
à la santé semblent par contre se renforcer
chez les adultes. Ils surveillent mieux leur alimentation
et ils boivent un peu moins: la part des Suisses n'ingurgitant
de l'alcool pas plus de deux fois par semaine ou pas du tout
progresse légèrement. Paradoxalement, les personnes
souffrant d'un excès de poids sont de plus en plus
nombreuses (35% contre 30% en 1992). De manière générale,
les Alémaniques apparaissent plus soucieux de leur
santé – ils font par exemple plus de sport que les
Latins – et se déclarent donc plus volontiers en forme.
A l'autre extrême, les femmes francophones (5,2%) et
surtout italophones (9,9%) sont particulièrement nombreuses
à se sentir mal, voire très mal. L'effet plus
marqué de la crise économique en Suisse latine
n'est sans doute pas étranger à ces différences
régionales devant la santé, indique Christophe
Koller, à la section santé de l'Office de la
statistique. Mais il se montre prudent dans l'analyse de ces
premiers résultats dans un domaine politiquement explosif
s'il en est. Il annonce d'ailleurs qu'une étude plus
fouillée est en cours sur le taux de malades plus élevé
chez les Latins ainsi qu'entre villes et campagne.
Enfin, bonne surprise, les personnes âgées ont
le moral, à lire les statistiques. Elles sont certes
deux fois plus nombreuses à souffrir de solitude que
les jeunes, et leur état de santé subjectif
est logiquement au-dessous de la moyenne. Mais la courbe du
bien-être psychique va croissant à mesure que
l'on avance en âge. Les statisticiens expliquent cette
amélioration ainsi: meilleure gestion du quotidien,
diminution du stress (retraite), présence d'un système
de sécurité efficace.
FRIBOURG.
Parlement des 13 à 16 ans
Comment les jeunes veulent réformer
leur canton
Les politiciens se plaignent souvent d'être coupés
de la base. Ce grief n'avait pas place hier matin à
Fribourg. Le Conseil d'Etat, in corpore, a répondu
directement, dans l'austère salle du Grand Conseil,
selon la procédure habituelle, aux motions de 130 députés
adolescents. Le but de cette session de cinq heures sortait
de l'ordinaire: permettre aux jeunes de 13 à 16 ans
d'introduire leurs revendications dans la nouvelle constitution
cantonale, attendue en 2003 lorsque nombre d'entre eux seront
majeurs.
Elus par leurs écoles respectives, les députés
en herbe ont débattu, comme les adultes, en allemand
ou en français sans traduction simultanée, des
diverses motions. Le débat a été particulièrement
vif à propos du permis de conduire dès 16 ans,
de la libéralisation de la consommation des drogues
douces, ou du droit des étrangers. Certains jeunes
députés ont vite saisi les règles de
l'efficacité parlementaire dans un canton bilingue.
Les différences de sensibilité entre Alémaniques
et Romands, citadins et campagnards à propos de l'écologie
ou de l'apprentissage des langues sont aussi apparues. Parmi
les propositions acceptées, citons l'apprentissage
de l'anglais dès l'école primaire, la mise en
œuvre d'une véritable égalité hommes-femmes,
ou l'instauration d'une plus grande protection de l'enfant.
Certaines propositions, prises au sérieux par le gouvernement,
ont de fortes chances de se concrétiser dans la constitution
ou ailleurs. C'est le cas notamment du droit de vote communal
des étrangers établis depuis dix ans ou la création
d'un parlement de jeunes.
W. B.
|
|