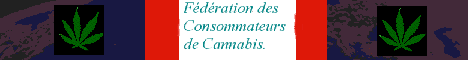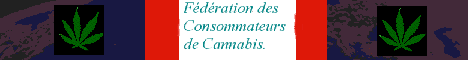VERRA-T-ON demain du cannabis
prescrit sur ordonnance ? L'éventualité n'a plus rien
de fantaisiste. Dans plusieurs pays, des brèches se sont ouvertes
dans l'interdit frappant l'usage de cette drogue. Tout récemment
en Grande-Bretagne et, avant cela, aux Pays-Bas ou dans certains
Etats américains, des décisions politiques ont permis de mener
des recherches qui se développent sur l'utilisation thérapeutique
du cannabis. C'est un retour aux sources puisque certaines
propriétés pharmacologiques de cette substance sont connues
depuis l'Antiquité.
Les Romains soulageaient les
femmes des douleurs de l'enfantement grâce aux vertus de Cannabis
sativa. Les propriétés sont redécouvertes vers les années
1840 par un jeune médecin irlandais travaillant à Calcutta,
W.B. Shaugnessy, qui les fait connaître à la communauté
médicale d'Europe et des Etats-Unis, en les administrant à
des patients atteints de la rage, de rhumatismes, d'épilepsie
ou de tétanos, rappelle Bertrand Lebeau dans sa préface à
la traduction française de l'ouvrage de référence d'Ed Rosenthal,
Dale Gieringer et Tod Mikuriya ( Du cannabis pour se soigner
[Marijuana Medical Handbook], Editions du Lézard, Paris,
1998). L'engouement est tel que, selon Jack Herer ( L'Empereur
est nu, Editions du Lézard), « de 1842
au tournant de ce siècle, le cannabis représentait la moitié
de la totalité des ventes de médicaments ».
PRINCIPE ACTIF DÉCOUVERT
L'usage médical de cette substance décline cependant vers
la fin du XIXe siècle. D'autres médicaments - notamment
les opiacés - sont isolés. Mais il faut attendre 1964 pour
voir l'identification du premier cannabinoïde, le delta-9
tétrahydrocannabinol, principal principe actif, par Raphaël
Méchoulam. Auparavant, après des mises en garde sur sa dangerosité,
le cannabis a été retiré de la pharmacopée américaine en 1941.
En France, la même mesure est prise en 1953.
Aux propriétés thérapeutiques
du cannabis connues de longue date, des publications scientifiques
récentes viennent, aujourd'hui, apporter des démonstrations
expérimentales dans des domaines nouveaux.
Les actions déjà connues.
Le cannabis est utilisé dans différentes indications :
douleur,
nausées et vomissements, stimulation
de l'appétit, mais aussi comme bronchodilatateur (dans l'asthme),
comme antispasmodique (dans la maladie de Parkinson et la
sclérose en plaques) ou comme vasodilatateur (dans le glaucome).
Les huit protocoles compassionnels américains concernent des
personnes souffrant de douleurs, de perte de l'appétit ou
de nausées, ainsi que de glaucome.
Propriétés antitumorales.
Le principal composé du cannabis, le delta-9 tétrahydrocannabinol,
et des cannabinoïdes de synthèse sont capable des faire régresser
des tumeurs cérébrales chez des modèles animaux. Les recherches
menées par une équipe madrilène, et publiées dans l'édition
de mars du mensuel Nature Medicine, pourraient ouvrir
une nouvelle voie thérapeutique contre les tumeurs gliales
chez l'homme, qui sont les tumeurs cérébrales primitives les
plus fréquentes.
Les traitements actuels de ces
cancers - agressifs et combinant chirurgie, radiothérapie
et chimiothérapie - ne parviennent qu'à permettre une survie
moyenne de 40 à 50 semaines. Ismael Galve-Roperh et l'équipe
de Manuel Guzman (université Complutense, Madrid) ont utilisé
des rats chez lesquels des cellules de gliomes ont été injectées
directement dans l'hémisphère cérébral droit afin d'y provoquer
la formation d'une tumeur. L'administration intratumorale
d'agonistes des cannabinoïdes, c'est-à-dire de substances
dont l'action va dans le même sens qu'eux, a permis d'éradiquer
la tumeur chez un tiers des animaux et a permis de prolonger
la survie d'un autre tiers. Pour le troisième tiers, les cannabinoïdes
n'ont eu aucun effet sur le cours de la maladie provoquée.
Selon l'équipe espagnole, sous l'effet des cannabinoïdes,
les cellules tumorales entrent en apoptose, un processus aboutissant
à la mort cellulaire. Sur le plan pharmacologique, ce phénomène
implique deux types de récepteurs cannabinoïdes, baptisés
CB1 et CB2, qui, activés par un agoniste, peuvent, indépendamment
l'un de l'autre, conduire à l'apoptose. Mais la démonstration
n'en a été faite qu' in vitro et non encore
in vivo.
Action antispasmodique.
Les cannabinoïdes permettent de contrôler la spasticité et
le tremblement dans un modèle animal de la sclérose en plaques.
Ce travail expérimental, mené par David Baker (University
College, Londres) et une équipe anglo-américaine, a été publié
le 2 mars dans l'hebdomadaire Nature. Plusieurs
agonistes des récepteurs cannabinoïdes CB1 et CB2 ont permis
d'améliorer les signes cliniques chez un type particulier
de souris, tandis que des substances antagonistes les exacerbaient.
Ce qui laisse à penser que le système cannabinoïde endogène
jouerait un rôle tonique actif dans le contrôle du tremblement
et de la spasticité. En France, l'Académie de médecine a pris
officiellement position en 1998 : « Des tentatives
d'applications thérapeutiques du cannabis et de ses dérivés
de synthèse ont été faites pour traiter la douleur, les vomissements
induits par la chimiothérapie du cancer, le glaucome, l'anorexie
des malades atteints du sida, la spasticité musculaire des
malades atteints de sclérose en plaques. Aucune supériorité
de ces produits n'a été démontrée à ce jour par rapport à
des médicaments classiques non toxicomanogènes utilisés dans
ces indications. » Un point de vue qui rejoignait
celui exprimé par l'Académie des sciences dans un rapport
sur les effets du cannabis, rendu public le 27 mars 1997.
Outre-Manche, l'Association médicale
britannique (BMA), qui représente les praticiens de ce pays,
s'est prononcée en faveur de l'usage médical du cannabis en
1997. Ce faisant, la BMA a attiré l'attention sur certains
dangers des cigarettes de marijuana, qui contiennent trois
fois plus de goudrons que les cigarettes de tabac, et sur
les effets indésirables de certains des 400 composants
(dont plus de 60 cannabinoïdes) du cannabis. Si la consommation
du cannabis sous forme de cigarettes est la plupart du temps
la seule accessible, les médecins britanniques appellent de
leur voeux la mise au point de médicaments à partir, notamment,
du delta-9 tétrahydrocannabinol.
Des essais cliniques sur les
bénéfices thérapeutiques du cannabis chez l'homme ont démarré
au mois de décembre 1999 en Grande-Bretagne, sous les auspices
du Conseil de la recherche médicale (MRC). Le laboratoire
GlaxoWellcome a, pour sa part, entamé des recherches similaires.
D'autres firmes pharmaceutiques se sont également intéressées
aux substances contenues dans le cannabis, mais à ce jour
seul un médicament contenant du tétrahydrocannabinol, le dronabinol
ou Marinol, a été mis sur le marché aux Etats-Unis.