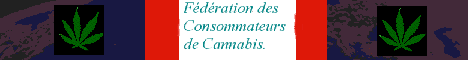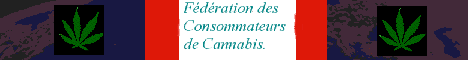Cannabis: les Suisses grands adeptes du joint
Au moins une fois par jour, 87 000 Suisses fument
du chanvre indien. Dont une moitié de jeunes qui goûtent
à la fumette. D'après l'enquête réalisée en novembre 2000 auprès
de 1600 personnes sur le phénomène cannabis, 27 % des
Suisses de 15 à 74 ans affirment avoir fumé un joint au
moins une fois dans leur vie, a relevé jeudi l'Institut
suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies
(ISPA) dans une documentation de presse. Le cannabis a
particulièrement la cote auprès des jeunes: 44 % des 15
à 19 ans et 59 % des 20 à 24 ans ont déjà goûté au moins
une fois à la marijuana ou au haschisch. Ils ne sont pas
les seuls à avoir fait cette expérience, puisque 35 %
des 25 à 44 ans et plus de 15 % des 45 à 49 ans ont au
moins une fois tiré sur un joint.
La répression ne paie pas
La répression, plus forte en Suisse romande qu'en Suisse
alémanique, n'a pas porté ses fruits: le pourcentage des
hommes ayant goûté au tabac défendu est plus élevé en
Suisse romande (39 %) qu'Outre-Sarine (32 %). La majorité
des adeptes du joint se procurent du cannabis auprès de
leurs copains et copines qui le leur donnent (49 %) ou
vendent (28 %). Un petit quart d'entre eux cultivent quelques
plantes du chanvre indien pour leur usage personnel. Ils
admettent en général une dépendance psychique.
Pas dans la rue
Les boutiques de chanvre sont très prisées en Suisse alémanique:
un tiers des consommateurs s'y approvisionne. Les produits
dérivés du cannabis sont rarement achetés dans la rue,
ce qui montre que ce marché n'a rien à voir avec celui
d'autres drogues, selon l'ISPA. Plus de la moitié de la
génération des 45 ans et plus (53 %) considère que les
jeunes expriment leur révolte en consommant du cannabis.
Les 15 à 24 ans sont seulement 38 % à y voir un acte de
rébellion. Pour 46 % d'entre eux, fumer du shit est un
remède, un moyen de lutter contre le stress de la vie
quotidienne.
Législation obsolète
L'interdiction du cannabis doit être réexaminée, compte
tenu de l'ampleur de la consommation et des faibles risques
de cette substance pour la santé, estime l'ISPA. La révision
de la loi sur les stupéfiants, actuellement en cours,
a pour objectif d'adapter la législation à la banalisation
de la consommation de cannabis. L'ISPA soutient cette
décriminalisation: la culture et la possession de petite
quantités pour la consommation personnelle doivent aussi
être dépénalisées, estime l'institut. Mais la consommation
dans des lieux publics doit être soumises à de strictes
restrictions.
Pas des criminels
De l'avis de 61 % des personnes interrogées, la consommation
de cannabis devrait effectivement rester interdite en
public, pour éviter de montrer le mauvais exemple à la
jeunesse. En revanche, 51 % d'entre elles approuvent la
culture de chanvre indien à usage personnel. Seules 30
% des sondés estiment que la police doit faire preuve
d'intransigeance à l'égard des fumeurs de joints. Une
petite minorité (15 %) les considère comme des criminels.
(gb avec les agences) 15.02.2001 - 11:45
Un Suisse sur deux accepte la vente libre du
cannabis

Selon une enquête de l’Institut
suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies
(ISPA), 50% des Suisses seraient favorables à une légalisation
du cannabis. 53% à une dépénalisation de sa consommation.
Et 54% à une libéralisation de la loi actuelle.
Cette enquête a été réalisée en novembre dernier
auprès de 1600 personnes âgées de 15 à 74 ans. Et ces
résultats ont de quoi réjouir le Conseil fédéral.
L’ISPA a sondé la population sur les quatre modèles
de réglementation en discussion. A savoir, la tolérance
vis-à-vis du cannabis, sa légalisation, sa décriminalisation
et son interdiction.
Certes, les avis restent partagés. Mais, si l’on
en croît les résultats de cette enquête, les Suisses soutiendraient
la nouvelle politique du gouvernement en la matière.
Une politique que d’aucuns n’hésitent d’ailleurs
pas à qualifier d’audacieuse. Et pour cause, contrairement
à ses voisins, la Suisse a décidé de s’engager tranquillement
mais sûrement sur la voie de la libéralisation.
L’an dernier, à l’issue d’une large
consultation, le gouvernement a esquissé les lignes directrices
d’une révision de la Loi fédérale sur les stupéfiants.
Qui envisage une dépénalisation de la consommation et
de l’achat de cannabis à des fins personnelles.
En outre, dans certains cas, le Conseil fédéral parle
d’autoriser la production et la vente de cannabis.
Et il se réserve même la possibilité de prévoir, par voie
d’ordonnance, une dépénalisation partielle de la
consommation d’autres drogues.
Avant de s’engager dans cette nouvelle voie, le
gouvernement s’était assuré du soutien des partis,
des cantons et des milieux concernés. Aujourd’hui,
à en croire l’enquête de l’ISPA, il peut également
compter sur l’adhésion d’un Suisse sur deux.
Mieux, en matière de dépénalisation du cannabis aussi,
les Suisses semblent prêts à défendre leur indépendance.
56% des personnes interrogées par l’ISPA souhaitent
en effet que la Suisse applique sa propre politique en
la matière. Même si celle-ci est contraire aux conventions
internationales sur les stupéfiants.
Une position qui aurait de quoi surprendre si le peuple
suisse n’avait pas déjà fait preuve d’une
certaine audace en matière de politique de la drogue.
En juin 1999, 54,4% des votants avaient approuvé la prescription
d’héroïne sous contrôle médical pour les toxicomanes.
Vanda Janka

La Suisse
juge positif le rapport des contrôleurs de la drogue
 |
 |
 |

"La culture et la vente de cannabis sont
devenues en Suisse un secteur d'activité
non négligeable", soulignent les experts
internationaux. [SRI] |
 |
 |
La Suisse est en train de devenir une
source importante de cannabis. Ce constat porte
la signature de l’Organe international de
contrôle des stupéfiants. Mais, à Berne, on parle
de malentendu et on fait une lecture constructive
de son dernier rapport annuel. |


|
On
a souvent l’impression que la politique suisse
en matière de drogue ne plaît guère à ceux qui sont
chargés d’observer la scène internationale
des stupéfiants. Il y a un mois, le Bureau des Nations
Unies de contrôle des drogues et de la prévention
du crime s’en était clairement pris, par exemple,
à son programme de prescription d’héroïne.
Cette fois-ci, c’est l’OICS, l’Organe
international de contrôle des stupéfiants, lui aussi
basé à Vienne, qui consacre à la Suisse la presque
totalité d’une page de son rapport annuel.
Cette instance quasi-judiciaire a pour mandat de
vérifier l’application des conventions des
Nations Unies sur les drogues. Bien qu’elle
soit financée et constituée par l’ONU, elle
jouit d’un statut indépendant et ses treize
membres exercent leur fonction à titre personnel.
L’intérêt qu’ils portent à la Suisse
dans leur dernier rapport s’explique par le
fait que quatre d’entre eux sont venus dans
ce pays en septembre 2000. Lors de cette visite
– la troisième en dix ans – ils ont
pu se rendre compte concrètement de la situation
et en discuter en tête-à-tête avec la direction
de l’Office fédéral de la santé publique.
«On a essayé, nous confie Ueli Locher, vice-directeur
de l’Office, de donner une image aussi complète
que possible de notre politique nationale en matière
de drogue. Le message a été compris.»
Les compliments, il est vrai, ne manquent pas. Qu’il
s’agisse de la qualité de la prévention, du
contrôle des activités illégales en rapport avec
des produits interdits ou de la collaboration avec
les instances internationales, la Suisse fait figure
de bon élève.
Mais en même temps, l’OICS ne s’embarrasse
pas de belles phrases quand elle met le doigt sur
la culture et la vente de cannabis qui selon elle
«sont en fait devenues en Suisse un secteur d’activité
non négligeable».
Mais «la libéralisation encore plus poussée qui
est envisagée – par exemple, la dépénalisation
générale de la culture et du commerce de cannabis
actuellement à l’étude – serait non
seulement contraire aux dispositions de la Convention
de 1961, mais également de nature à aggraver le
problème au lieu de le résoudre.»
Ueli Locher ne nie pas les problèmes mais parle
de malentendu et de défaut de communication. Il
n’a jamais été question, ni au Conseil fédéral
ni au Parlement, de légaliser le cannabis. Par contre,
il convient de voir si ceux qui en font commerce
doivent être poursuivis dans tous les cas.
Le sous-directeur de l’Office fédéral de la
santé publique fait tout de même observer que les
organisations internationales devraient comprendre
que les temps changent: «si on regarde les sondages
d’opinion, on voit bien qu’il est de
plus en plus difficile de faire comprendre que le
cannabis devrait être traité de la même façon que
la cocaïne ou l’héroïne».
Faut-il donc revoir les conventions internationales
et les adapter à l’évolution des mentalités
et des mœurs? Ueli Locher ne dit pas cela,
mais pense que le droit existant laisse une marge
d’interprétation qui permet d’ajuster
les politiques nationales aux réalités sociales.
Le second grand reproche fait par l’OICS à
la Suisse concerne les lieux d’injection de
drogues sans prescriptions médicales: quand on a
un système de santé aussi développé, dit le rapport,
on devrait être en mesure de «fournir toutes sortes
de moyens de traitement, plutôt que d’aménager
des locaux qui contribuent à prolonger et à faciliter
l’abus des drogues dans des soi-disant bonnes
conditions d’hygiène».
Ce jugement, Ueli Locher, ne peut le partager. C’est,
dit-il, «un combat d’arrière-garde»: la Suisse,
mais aussi d’autres pays comme l’Allemagne,
les Pays-Bas et l’Espagne, ont procédé à des
expertises qui démontrent que de telles pratiques
ne contredisent pas les conventions internationales.
A Berne, on se veut donc rassurant, confiant et
constructif. Les paragraphes critiques du rapport
de l’OICS ne devraient pas masquer l’essentiel.
Et l’essentiel, selon Ueli Locher, c’est
bien que «notre approche globale en matière de drogue
a été comprise».
Bernard Weissbrodt
|

|
21.02.2001 - 17:00
|
|
................................. |
Cannabis:
l'Europe
balance entre répression et dépénalisation

La dépénalisation
de la consommation du cannabis placerait la Suisse dans le groupe
des pays européens optant pour une prudente libéralisation. L’Union
n’affiche aucune cohérence en la matière, malgré une tendance
favorable à la tolérance.
Parmi les pays les plus répressifs, la France
ne fait pas la différence entre drogues douces et dures. La seule
consommation de cannabis peut valoir un an de prison. Une prohibition
peu efficace à en croire une récente étude gouvernementale qui
révèle que 45% des adolescents de dix-sept ans ont déjà expérimenté
le cannabis.
A l’opposé, les Pays-Bas sont connus pour leur permissivité,
symbolisée par les fameux coffee-shops. La vente de cannabis y
est autorisée aux clients de seize ans révolus, la production
de petites quantités est tolérée.
Toutefois les autorités néerlandaises ont durci leur politique
depuis les années septante, notamment sous la pression des habitants
des quartiers investis par les trafiquants et leurs clients. Depuis
deux ans, les motifs de fermeture des coffee-shops sont étendus.
La Belgique a opté le mois dernier pour une dépénalisation qui
ne dit pas son nom. La détention et la consommation de cannabis
pour usage personnel ne seront en principe plus sanctionnés. «En
principe» parce que le gouvernement a prévu une étrange exception
pour la consommation induisant «un comportement problématique»
ou une «nuisance sociale», concepts qui restent à définir.
La plupart des politiques nationales se caractérisent par un écart
entre la législation et la pratique. C’est le cas notamment
en Italie, en Allemagne, en Autriche et au Danemark, où la consommation
privée n’est généralement pas sanctionnée, alors que la
loi prévoit des condamnations.
L’Union européenne, de son côté, cherche à harmoniser la
lutte contre le tabagisme, mais elle ne prévoit aucune norme commune
face au cannabis. Toute tentative se heurterait fatalement à des
perceptions très divergentes. La France avait reporté la suppression
des contrôles à la frontière avec la Belgique de peur d’être
envahie par les dealers venus des Pays-Bas.
Thierry Zweifel, Bruxelles
|